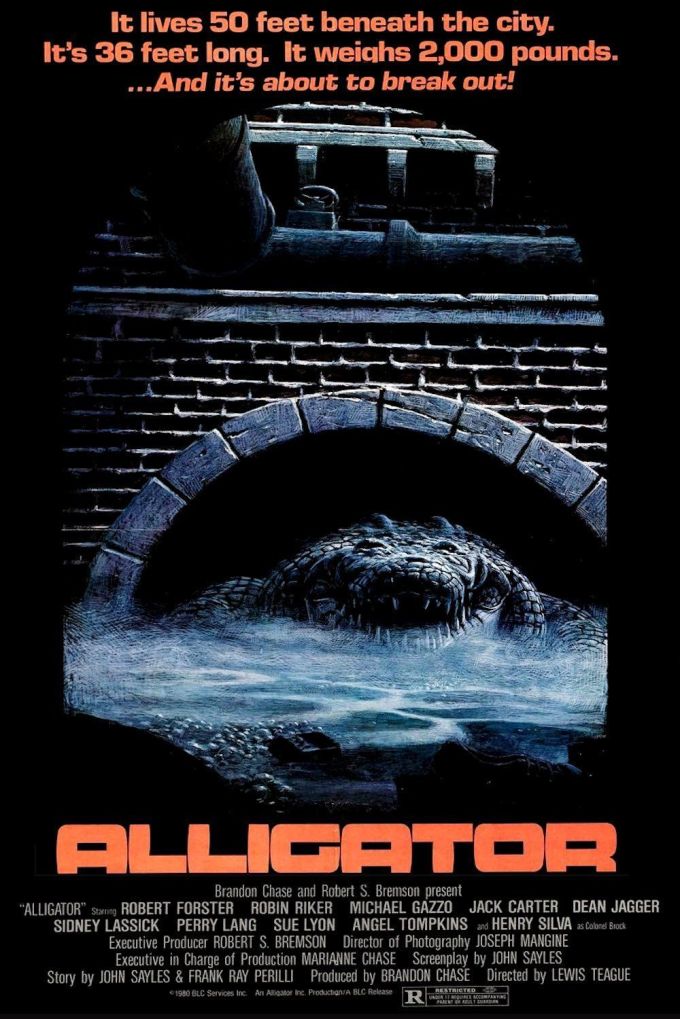Enfin ! Il est venu l’heure, sonnez trompettes et clairons, nous allons parler d’un vrai nanar ! Après deux critiques mi-figue mi-raisin sur deux séries B compétentes mais inégales, il est bon de tomber sur un véritable ratage filmique. Une production Roger Corman qui plus est !
Qu’on se la tienne pour dite, Corman est un pape du cinéma. Pas seulement du cinéma de genre ou de la péloche de Drive-In dont ce fut pourtant son fonds de commerce, mais bien du cinéma tout court. Sans Roger Corman, nous n’aurions probablement jamais pu voir naître des légendes comme Coppola, Scorsese, James Cameron, Peter Bogdanovitch ou Joe Dante. Corman donnera à Jack Nicholson ses premiers rôles et à James Horner l’occasion de composer ses premières bandes originales.
La technique de Corman était de tourner vite et pas cher, avec de jeunes passionnés derrière la caméra. Corman c’était une école et un savoir-faire, mais aussi un défi lancé à l’esprit de la débrouillardise. Avec une telle philosophie, il n’était pas rare que les films sacrifient la qualité au profit de l’efficacité. D’autant que Corman s’est principalement illustré dans le cinéma d’exploitation, d’horreur et de science-fiction.
Sorti en 1959, La Femme Guêpe semble particulièrement fauché. Après une scène d’introduction tournée en extérieur dans ce qui doit passer pour un centre d’apiculture, la totalité du métrage se déroulera en studio, figurant les bureaux d’une entreprise, un lit d’hôpital, un laboratoire ou un bar. L’unique plan censé se dérouler en ville sera tourné en gros plan sur un bord de trottoir, laissant l’accident de voiture se produire hors-champ. Les vues de la ville sont très clairement des photographies agrandies accrochées aux fenêtres.
Le tournage n’a très probablement pas excédé une semaine, si ce n’est moins. Le choix du noir et blanc est lui aussi économique, en plus de faciliter l’illusion des rares moments sanglants. Comme c’était la tradition, l’affiche du film promet bien plus que le métrage lui-même.
Mais quid de l’histoire me direz-vous ? Le docteur Zinthrop (Michael Mark), de nationalité incertaine, est remercié de son poste au centre d’apiculture suite à ses expériences sur la « gelée royale » de guêpe alors qu’il était censé s’occuper des abeilles. L’entomologiste dans la salle s’esclaffe ! La confusion entre les espèces sera d’ailleurs une constante, les seuls insectes présents à l’écran étant clairement des abeilles, comme c’est le cas dans le générique bourdonnant. Le concept de cette « gelée » n’est pourtant pas sans mérite, cette substance étant effectivement utilisée dans certains produits de beauté et autres régimes.
Zinthrop propose ses services à Janice Starlin (Susan Cabot), PDG d’une grande entreprise de produits cosmétiques dont elle fut aussi longtemps l’égérie. Seulement voilà, les années et la société « âgiste » sont cruelles et Starlin se fait trop âgée aux yeux de ses collaborateurs masculins pour continuer à utiliser son faciès comme argument de vente. On soupçonne que la jeune secrétaire de Starlin pourrait être le nouveau visage de la compagnie.
Si le propos de fond, clairement féministe, est assez en avance sur son temps, la logique est claudicante. Pourquoi ne pas simplement utiliser la même photo chaque année, voire un dessin plutôt que de soumettre l’image de la firme au temps ? La naïveté du film sur le traitement de son problème initial est autant charmant que risible.
Au moyen d’un hamster puis d’un chiot, Zinthrop fait à Janice la démonstration de son sérum à base de gelée royale de guêpe, permettant le rajeunissement des tissus. Là encore le montage trahit l’extrême pauvreté du budget, la transformation se produisant hors-champ, soutenue par une musique illustrative.
Janice Starlin n’en pas moins convaincue et commence sa cure, qui a pour effet immédiat de la libérer du maquillage au crayon noir servant à la vieillir, et de révéler son véritable minois, tout à fait charmant. Après une série de montages d’activités en entreprise digne d’un film promotionnel, et de quelques discussions au bar entre employés à l’air pénétré, l’élément perturbateur arrive enfin. Zinthrop se fait attaquer par son chat, à qui il avait injecté le sérum. Contraint de tuer la pauvre bête, le bon docteur décide de quitter la firme, pour être ensuite heurté par une voiture, évidemment hors-champ. Là encore, les effets sonores pallient à l’absence de budget.
Inquiète et désorientée par cet accident, Janice redouble d’injections et les effets secondaires ne tardent pas à se manifester. Notre PDG en quête de jouvence se transforme ainsi, après une crise de migraine annonciatrice, en monstre insectoïde suceur de sang.
Vous vous doutez que la transformation se fait hors-champ et qu’au plan suivant, la femme-guêpe promise par le titre se résume à un masque rigide de mouche noir et des mitaines assorties pour figurer les pattes griffues.
A partir de là, les événements s’enchaînent de manière mécanique, avec séries de meurtres, le plus souvent hors champ ou à grand coup de sirop de chocolat pour évoquer le sang, jusqu’à ce que notre pauvre Janice succombe, défenestrée après avoir reçu une fiole d’acide en plein dans le masque. L’actrice Susan Cabot sera d’ailleurs blessée par le produit utilisé. Le bellâtre de service sauve la belle secrétaire, la morale est sauve même si l’on ne peut s’empêcher de sentir chez Corman une note d’ironie cruelle.
La Femme-Guêpe peut être vu comme la limite du modèle Corman de l’époque, où malgré plusieurs trouvailles pour palier au budget rachitique, la pauvreté de l’ensemble saute aux yeux du spectateur moderne. Ajoutons à cela plusieurs scènes de palabres devenant comiques par leur vacuité et un enchaînement de scènes parfois brutal, et vous avez un sympathique petit nanar, parvenant à fusiller un postulat pourtant intéressant. Les acteurs restent cependant plutôt dignes, à commencer par Susan Cabot dans le rôle principal.
Le film aura droit à un remake en 1995, dans le sillage de La Mouche de Cronenberg. Le film de Corman s’inspirant de La Mouche Noire de Kurt Neuman sorti un an auparavant, la symétrie n’en est que plus logique. Ce remake ne semble pas mieux réussi, et préfère jouer la carte de l’érotisme facile, avec une femme guêpe certes impressionnante mais montrant clairement ses attributs mammaires. Il faut dire que le réalisateur, Jim Wynorski, est un fieffé érotomane, spécialiste du « plan nichon ».
Pour voir un film potable usant d’un postulat similaire à celui de Corman, procurez-vous le méconnu The Rejuvenator (1988) de Brian Thomas Jones avec Vivan Lanko dans le rôle d’une actrice vieillissante cruellement évincée par l’industrie et qui trouve dans la formule chimique d’un certain docteur Ashton la promesse d’une nouvelle jeunesse. Vous vous doutez bien que le sérum aura de terribles effets secondaires.
Au risque de changer radicalement le ton de cette chronique, Il est difficile de ne pas conclure sans parler du triste destin de Susan Cabot. Née Harriet Pearl Shapiro, l’interprète de la femme guêpe fut en effet une actrice de westerns prolifique dans les années 50, avant de retourner au théâtre. Sa participation au film de Corman sera l’une de ses dernières contributions au septième art avant de vivre les deux décennies suivantes dans un isolement quasi-total, ponctué de crises sévères de dépression, peurs irrationnelles et pensées suicidaires. Orpheline et ayant grandi dans 8 foyers différents, elle fut victime d’abus sexuels dans sa jeunesse dans le Bronx, ce qui explique ses troubles psychologiques.
Les épreuves de Susan Cabot se transmettront à son unique enfant Timothy, atteint de nanisme et s’étant lancé dans le culturisme, dans le vain effort de gagner le respect de sa mère et guérir de ses complexes. La relation entre mère et fils se détériorera de manière définitive, jusqu’au jour où Timothy battra à mort sa génitrice devenue agressive à l’aide d’une barre d’haltères. Susan Cabot n’avait que 59 ans.
Une fin horrible mettant un point final à une existence déjà bien tragique, et qui raisonne étrangement avec le rôle de Janice Starlin, celui d’une femme en proie à des démons intérieurs nourris par une société cruelle, la menant à des crises de violences qui scelleront son destin.
Le cinéma cache bien des histoires sordides, et la série B ou le Nanar n’y font pas exception. Pour chaque « success story », combien de destins brisés ? Si La Femme Guêpe n’est pas le meilleur écrin pour la postérité de Susan Cabot, cette production Corman n’en demeure pas moins le ticket pour l’immortalité, à celle qui fut si cruellement écartée des projecteurs par le poids de ses blessures.