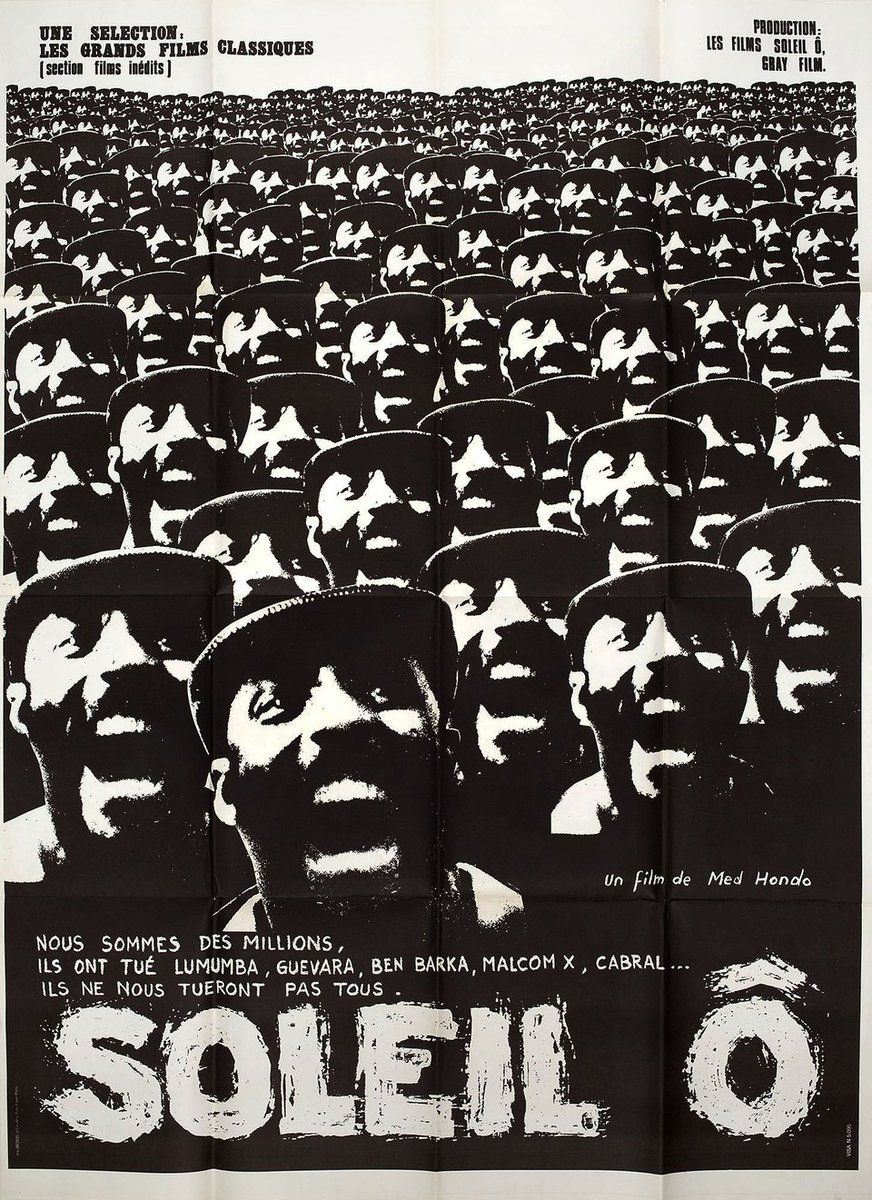En 2020, Pierre-William Fregonese m’avait approché ainsi que d’autres fans de la franchise Détective Conan afin de répondre à ses questions et d’enrichir son ouvrage. Le produit final, dont nous avons fait ici la critique n’a retenu qu’une part infime de mes contributions. N’ayant signé aucune close d’exclusivité ni de discrétion auprès de l’auteur ou de l’éditeur Pix’n Love, je reproduis ici les questions de Fregonese et mes réponses dans leur intégralité. Compte tenu des récents développements de la franchise sur le territoire français avec la distribution des trois derniers films en date par Eurozoom, certaines des déclarations suivantes ne sont plus totalement d’actualité.
-Comment avez-vous découvert Détective Conan, et pourquoi avoir décidé de vous investir sur un forum de fans ?
J’ai découvert Détective Conan en 2004 lors de sa diffusion sur Cartoon Network. La culture manga et anime en Suisse était très en retard par rapport au reste de l’Europe, surtout la France, et ce fut donc l’une des premières séries animées adaptées de manga que j’ai regardée de manière soutenue. Grand amateur de récits d’enquêtes et de résolution d’énigmes, la série m’a tout de suite charmée. Plus tard, après une première interruption de la diffusion de l’anime, j’ai découvert que le manga en était déjà à son 52ième tome.
Cette longévité m’avait intrigué et j’ai commencé à acheter régulièrement les tomes que je dévorais. Ce fut ma porte d’entrée vers la pop culture japonaise en général et par voie de conséquence, sur l’infra-monde d’internet, qui n’avait pas la même ubiquité qu’aujourd’hui. De fil en aiguille, j’ai découvert l’existence de forums dédiés à DC et celui de Beika Street me plaisait énormément pour sa dimension créative, étant moi-même dessinateur amateur depuis tout jeune.
C’est à l’occasion d’un projet de « Beikalendar », un calendrier dessiné par les membres représentant des personnages de la franchise, que j’ai décidé de m’inscrire sur Beika Street en décembre 2009. A partir de là, j’ai commencé sans vraiment m’en rendre compte à prendre une place importante dans l’activité créatrice du forum et plus tard sur la recherche d’informations sur les nouveaux chapitres encore inédits chez nous. Étant d’un naturel solitaire et méfiant, partager une passion encore peu avouable à l’époque dans la vie de tous les jours était un moyen de trouver enfin un tissu social approprié.
-Quelle est votre affaire préférée ?
C’est très difficile à dire, car il y a tellement d’affaires que j’aime pour des raisons très différentes. Celle dont je ne me remets pas reste l’affaire des « Inséparables », deux sœurs vivant ensemble. L’une d’elle, ne supportant plus cette cohabitation, décide de supprimer l’autre, et d’utiliser Kogoro complètement séduit, pour l’innocenter du crime.
On apprend plus tard que la criminelle a dû changer de stratégie car son premier plan, consistant à faire respirer des vapeurs toxiques obtenues par le mélange de deux produits ménagers, avait échoué. C’est parce que la victime, consciente du danger, avait retiré les produits, par amour pour cette sœur qui la tuera plus tard. Se rendant compte de l’horreur de son crime, la coupable démasquée serre le corps inanimée de sa sœur, le seul être qui l’aimait pleinement.
-Que pensez-vous de son adaptation en animé ?
L’animé est le médium qui m’a permis de découvrir la série et j’ai donc encore un souvenir ému des 150 premiers épisodes avant l’arrêt de sa diffusion dans les pays francophones. Néanmoins, le manga me permet une plus grande liberté d’interprétation et contrairement à l’animé, je peux lire le manga légalement sans avoir à prendre un abonnement pour une plateforme de streaming. L’animation a aussi beaucoup de hauts et de bas, comme toute série fleuve, ce qui peut parfois diminuer le plaisir du visionnage. Les films d’animation sont de grosses friandises, très formatées mais souvent divertissantes.
– De quelles autres œuvres rapprocheriez-vous Détective Conan ?
Détective Conan est en partie inspirée de Lupin III, vénérable franchise créée en 1967 par Monkey Punch et adaptée sur tous les supports. Ce sont les crossovers avec Détective Conan qui m’ont permis de découvrir Lupin. Il est donc toujours plaisant de trouver les influences disséminées dans l’œuvre d’Aoyama. A part des émules très évidents comme le manga Maho-tantei Loki qui possède aussi un protagoniste rétréci, je trouve beaucoup de similitudes avec la bande-dessinée et le dessin animé dérivé de Billy the Cat, scénarisé par Raoul Cauvin. Cette série partage avec DC un protagoniste emprisonné dans une forme limitante, l’impossibilité de le dire à ses êtres chers, une quête pour retrouver sa forme d’origine et un récit initiatique où cette contrainte lui apprend à corriger ses erreurs passées.
–Vous êtes au contact des fans, ils préfèrent le manga ou l’animé ? Et pourquoi ?
Je vois vraiment de tout, même si j’ai l’impression que les fans les plus jeunes sont beaucoup plus sensibles à l’image en mouvement qu’à l’art séquentiel mais ils restent très enthousiastes à chaque nouvelle concernant les nouveaux chapitres du manga et beaucoup achètent régulièrement les tomes. Leurs préférences me semblent dépendre plus de la présence de leurs personnages préférés qu’une appétence pour un médium spécifique.
-Votre site avait un forum. Quels étaient les grands sujets qui revenaient et passionnaient les internautes ? L’identité du chef des Hommes en noir, la romance entre Shinichi et Ran, le Kid ou autre chose ?
Je suis arrivé sur le forum lorsqu’il était déjà indépendant du site d’origine. Tous les sujets pouvaient passionner les membres, lors de notre pic d’activité à la fin des années 2000 et début des années 2010, il était rare qu’un sujet n’inspire pas la discussion.
A présent que la face d’internet a changé, où les forums ont été largement évincés par les réseaux sociaux, il est beaucoup plus difficile de savoir ce que les internautes aiment vraiment ou d’engager une discussion construite. Discord, malgré ses défauts, est l’une des meilleures options pour maintenir l’activité de la communauté de Beika Street, après que le forum ai changé une nouvelle fois d’hébergeur.
De nos jours, les personnages « badass » et liés à l’intrigue comme Akai Shuichi, Amuro Tooru ou encore Wakasa Rumi semblent maintenir l’intérêt. Mais les romances et le charismatique Kaito Kid ont encore de fervents admirateurs.
-Si vous aviez à faire un portrait-robot du fan de Détective Conan, quels seraient ses traits principaux ?
Il est ou a été très porté sur la création, notamment en fan-fics, les Français étant après tout un peuple doté d’une forte conscience littéraire. Ils expriment aussi des tendances genrées relativement marquées où les fans masculins et féminins aiment différentes choses, même si ces différences tendent aujourd’hui à s’estomper.
La communauté francophone étant l’une des plus anciennes en activité (les anglo-saxons n’ont découvert Détective Conan qu’assez tard en comparaison), il y a le sentiment d’une plus grande division générationnelle. Pensez que les fans francophones peuvent avoir entre 15 et 45 ans ! Je dénote aussi peut-être une plus grande lassitude.
Comme en France nous attachons une grande importance à l’intégrité artistique et à la qualité au-delà du divertissement, voir une histoire trainer en longueur et dévier légèrement de sa trajectoire initiale peut produire des frustrations et désistements. Mais c’est aussi une communauté qui se renouvelle, en partie grâce aux nouveaux personnages.
-Pour vous, quels sont les films les plus réussis ? Et pourquoi ?
Les films les plus réussis sont pour moi les premiers car les producteurs n’avaient pas encore codifié la formule, ce qui permettait aux différents métrages de ne pas être de complètes redites des précédents. Les films 5 et 6 ont beaucoup d’admirateurs, et on peut les comprendre. Le 5 voit l’entrée des hommes en noir sur grand écran et le 6 ravira les sherlockiens.
De mon côté je considère le tout premier film « Compte-à-Rebours dans un Gratte-Ciel » comme le meilleur car il a pour lui l’effet de surprise, une simplicité de narration, des choix d’angles de caméra inspirés et surtout l’inclusion d’une vraie Némésis plutôt qu’un citoyen lambda comme criminel principal, quelque chose de rare dans la franchise si on excepte les Hommes en Noir. Et à l’intérieur de ce film, il y a un cœur et un sentiment presque élégiaque où on pourrait presque accepter la fin de la série animée.
Le premier film était d’ailleurs au départ conçu en tant que tel, Aoyama ayant songé à arrêter la franchise à ce moment et utilisant des éléments de sa fin prévue pour Magic Kaito pour inspirer les scénaristes du film. Dans les métrages plus récents, le film 23 parvient selon moi à équilibrer tous les ingrédients qui se sont progressivement ajoutés à la formule, entre des scènes d’action généreuses, une romance assez solide avec un dilemme crédible ainsi que du fan-service un peu mieux dosé que ses prédécesseurs.
-Que pensez-vous des adaptations en jeu vidéo ? Quels sont les jeux les plus réussis et pourquoi ?
Hélas je ne joue pas au jeux-vidéos en général et encore moins à ceux tirés de Détective Conan. Il faudra trouver une autre personne à interroger sur cette question. J’avoue ne pas voir beaucoup de gens en discuter dans la communauté, probablement parce qu’aucun ne semble avoir été localisé chez nous.
-Comment voyez-vous la notoriété de Conan en France ? Ça continue de fonctionner ou ça se tasse depuis quelques années ?
Détective Conan a une communauté de fans très dévoués en France, même si elle parait confidentielle en comparaison avec des phénomènes comme les différentes séries du Shonen Jump ou encore Jojo. La fin de la diffusion de l’animé en France a sans doute joué un rôle dans le ralentissement de sa croissance.
Néanmoins on constate depuis quelques années un regain d’intérêt, entre la diffusion de l’animé sur des plateformes de streaming légal, les projets de sorties DVD par BlackBox, malgré la controverse liée à leur mauvaise gestion de la publication, et des projets de diffusion des films sur grand écran en France.
Il serait présomptueux de ma part de prédire l’avenir de Conan dans les pays francophones mais je pense que le meilleur moyen de le perpétuer est de continuer nos activités sur la toile et de convaincre les ayants-droits et les différents éditeurs à sortir et localiser plus d’épisodes et de films d’animation, l’animé ayant une capacité fédératrice très grande. Pour le moment, DC est une franchise historique, qu’on aime encore malgré les lassitudes, entre nostalgie et renouvellement.